Peut-on encore aimer travailler… même en juillet ?
Peut-on encore aimer travailler ? Oui, mais différemment. Moins par idéal, plus par équilibre. Moins dans la fusion, plus dans la clarté. C’est une transition majeure pour les employeurs : elle appelle des outils de pilotage adaptés (baromètres sociaux, plateformes d’écoute, ateliers managériaux), mais surtout une révision de fond du contrat implicite entre l’entreprise et ses collaborateurs.
7/7/20252 min read
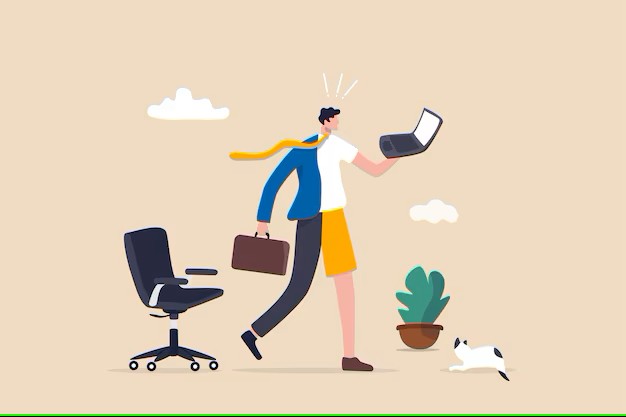

Les vacances d’été ne suspendent pas le rapport au travail. Elles l’éclairent.
Le mois de juillet agit comme un révélateur.
En creux de la pause estivale, une question resurgit pour certains : que reste-t-il de mon envie de travailler ?
Depuis quelques années, une rupture s’installe. Le rapport au travail change, sans fracas, mais en profondeur. Moins d’adhésion, moins d’attente, moins d’illusion.
Ce n’est pas une crise passagère. C’est une bascule de fond : l’idée même d’aimer son travail ne fait plus consensus.
Et si ce n’était pas un problème, mais un rééquilibrage salutaire ?
1. Moins de passion, plus de distance : la nouvelle norme ?
La promesse d’un travail épanouissant, riche de sens et de reconnaissance a longtemps structuré les politiques RH. Aujourd’hui, elle s’effrite.
On ne parle pas d’un désengagement brutal, mais d’un recul assumé : les salariés veulent bien travailler, mais sans se confondre avec leur travail.
Ils ne fuient pas la mission : ils refusent simplement l’absorption.
Ce changement de posture n’est pas un problème à résoudre, mais une réalité à intégrer dans les pratiques managériales et la stratégie RH.
2. Quand la quête de sens devient une injonction de trop
Donner du sens au travail reste un axe fort de la marque employeur. Mais à force d’en faire un slogan, l’effet s’inverse. Beaucoup n’y croient plus.
L’entreprise ne peut pas combler un vide existentiel. Elle peut proposer un cadre clair, du respect, de l’utilité — mais pas une vocation.
C’est ce que révèlent de plus en plus de baromètres QVCT : les attentes des salariés se recentrent sur le concret, le juste équilibre, le climat de travail, la qualité du management… bien avant l’“épanouissement”.
3. Redéfinir l’engagement sans culpabiliser
On confond encore trop souvent engagement et surinvestissement.
Or, la majorité des salariés veulent s’impliquer – à leur juste place, avec des repères sains.
Ce changement de référentiel impose une évolution de la posture managériale :
Clarifier ce qu’on attend,
Oser cadrer sans infantiliser,
Valoriser le travail bien fait sans exiger l’adhésion totale.
C’est aussi une voie de prévention des RPS : quand l’engagement est bien posé, il est durable. Quand il repose sur des ressorts affectifs ou moraux, il devient toxique.
4. Faire du travail un cadre, pas une promesse
Et si le travail redevenait ce qu’il a toujours été : un contrat, un cadre structurant, une contribution — sans mise en scène de la passion ?
Ce n’est ni du cynisme, ni du renoncement.
C’est peut-être la condition d’un rapport au travail plus apaisé, plus réaliste, plus soutenable.
Et paradoxalement, c’est dans cette lucidité-là que peuvent renaître la fierté, la loyauté, voire… une forme d’attachement.
contact@kairysis-consulting.com
Socials
+33 7 67 64 26 48
Toulouse, France



